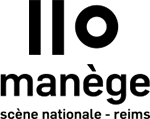BIOGRAPHIES
LUCINDA CHILDS
Au début des années 1960, Lucinda Childs étudie la danse auprès de Merce Cunningham et Robert Dunn. Elle est membre fondatrice du Judson Dance Theatre en 1962. À l’instar de ses collaborateurs, Childs tente alors de brouiller la ligne franche séparant habituellement les danseurs des non-danseurs. Dans une oeuvre emblématique de cette période, Street Dance (1964), la chorégraphe demande aux spectateurs de l’observer à travers les fenêtres d’une pièce donnant sur la rue avoisinante. Lorsqu’elle fonde la Lucinda Childs Dance Company en 1973, ses partitions se caractérisent par l’utilisation d’une série restreinte de gestes. Répétés par tous les danseurs selon des configurations et rythmes variés, ceux-ci singularisent le corps tout en uniformisant le mouvement. Les parties dansées de l’opéra Einstein on the Beach par Robert Wilson et Philip Glass (1976), dont elle est responsable, découlent directement de cette recherche.
Par la suite, la musique joue un rôle de premier plan (avant 1976, ses chorégraphies sont dépourvues d’accompagnements musicaux). Dance (1979) fait ainsi s’interpénétrer la structure répétitive des compositions de Philip Glass et les cycles de mouvements réitérés des interprètes. Ces collaborations se poursuivent avec Frank Gehry et John Adams (Available Light, 1983), ainsi que Robert Mapplethorpe et Michael Nyman (Portraits in Reflection, 1985). Parallèlement au répertoire dédié à sa compagnie, Childs crée des partitions chorégraphiques pour plusieurs troupes de ballet (les Ballets de l’Opéra de Paris, Pacific Northwest Ballet, les Ballets de l’Opéra de Berlin, les Ballets de l’Opéra de Lyon, les Ballets de Monte-Carlo, les Ballets de l’Opéra de Genève, etc.) À partir de 1992, elle met également en scène des livrets d’opéra classiques et contemporains.
Lucinda Childs a reçu la Bourse Guggenheim en 1979, l’année où elle a crée Dance. Elle a également reçu la récompense : NEA/NEFA American Masterpiece Award, et en 2004 elle est passée du rang d’officier à celui de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres français. En 2009, elle a créé la chorégraphie de Tempo Vicino sur la musique de John Adams pour le National Ballet de Marseille
SOL LEWITT
Protagoniste majeur de l’art conceptuel et minimal, Sol LeWitt est avant tout célèbre pour ce qu’il nomme ses “ structures ”, des sculptures mettant en scène des éléments géométriques établis en réseaux. Issu de l’université de Syracuse, le jeune homme séjourne en Europe avant de s’engager dans l’armée américaine durant la guerre de Corée. Il réside ensuite à New York, où il est graphiste pour Seventeen et travaille comme réceptionniste au Museum of Modern Art.
Ses Incomplete Open Cubes explorent la figure du carré et ses potentielles combinaisons. Les volumes s’imposent alors comme des entités en relation avec 122 possibilités de cubes incomplets.
Dès 1968, l’artiste conçoit également des dessins à exécuter à même le mur, accompagnés d’un certificat et d’un diagramme qui permettent à des assistants de les réaliser. Le plasticien offre ainsi une création bi-dimensionnelle, dans laquelle le cheminement intellectuel - constitué d’esquisses, de modèles, d’études ou de conversations - prime sur l’objet final. Cette distinction entre conception et réalisation scelle l’autonomie de l’œuvre, sa forme ne dépendant pas de la subjectivité du créateur.
Exposé à la John Daniels Gallery de New York en 1965, comme au San Francisco Museum of Modern Art en 2000, l’art de Sol LeWitt convie alors le spectateur à une exploration mentale, autant qu’il redéfinit l’expérience de la sculpture. Protéiforme, il questionne les notions de sérialité et de modularité et pose la notion d’agencement comme valeur esthétique, influençant des artistes majeurs tels que Daniel Buren.
PHILIP GLASS
Précoce, Philip Glass obtient une licence à l’Université de Chicago à dix-neuf ans, puis fréquente la Juilliard School à New York. En 1963, lorsqu’il rejoint la France et fréquente les cours de Nadia Boulanger, il accepte un travail ponctuel de transcription des improvisations du musicien indien Ravi Shankar pour la musique du film Chappaqua. Il découvre alors passionnément, avec ce dernier ainsi que le joueur de tabla Alla Rakha, les structures répétitives à évolution lente et graduelle. En 1966, il voyage en Inde, sympathise avec les réfugiés tibétains et s’imprègne des philosophies hindouiste et bouddhiste.
De retour à New York en 1967, il s’installe à Chelsea. Il fonde le « Philip Glass Ensemble ». Le premier style, sévère minimalisme, le mènera jusqu’au milieu des années soixante-dix et semble s’achever avec Music in twelve Parts. Une commande prestigieuse vient alors, qui sera suivie d’une célébrité soudaine avec Einstein on the Beach de Robert Wilson, chorégraphié par Lucinda Childs et né au Metropolitan Opera en 1976.
Aujourd’hui, cette production toujours croissante compte une vingtaine d'opéras, huit symphonies, de nombreuses œuvres concertantes et une quantité non moins impressionnante de musique de chambre.
The Voyage (1992), composé pour le 500ème anniversaire de la découverte des Amériques, grâce à une commande du Metropolitan Opera, est l'opéra qui marqua l'œuvre de Glass. Suivront notamment trois opéras transversaux inspirés de la pluridisciplinarité actuelle, intéressantes « greffes » sur le cinéma de Cocteau : Orphée (1993), La Belle et la Bête (1994) et Les Enfants Terribles (1996).
Glass, « ambassadeur de la musique savante » auprès des stars et de la musique populaire, est en cela l'exemple presque unique, qui aura côtoyé (et parfois collaboré avec) Paul Simon, Susan Vega ou David Bowie. En 2007, il écrit Book of Longing sur un cycle de chansons et de poèmes écrits par Leonard Cohen. Il abordera avec le même appétit l’écriture de musiques de film, comme Candyman (1992), Truman Show (1998), The Hours (2003) ou plus récemment Le Rêve de Cassandre de Woody Allen.